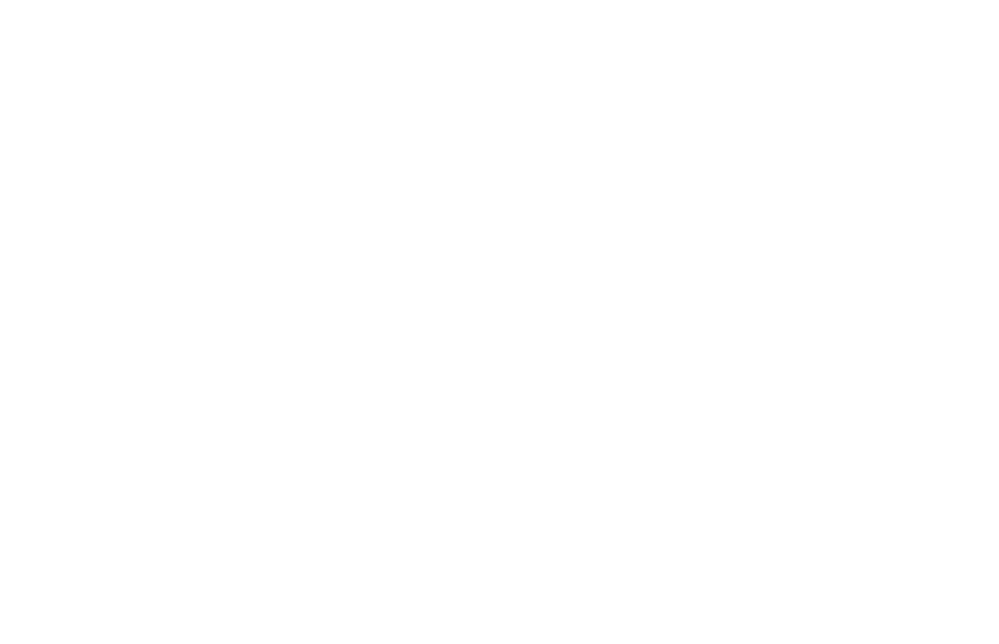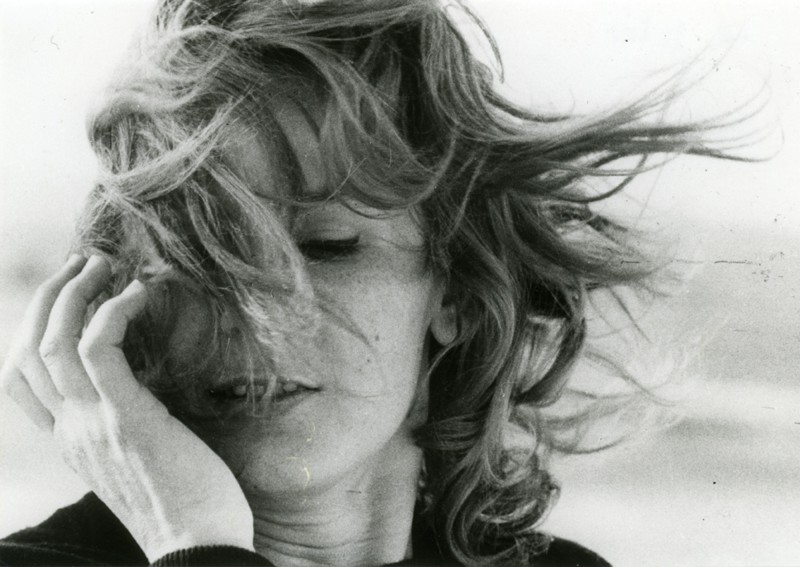Édition 2011
From here on
L’OR DU TEMPS
Ma voiture s’appelle Picasso
Ceux qui naissent aujourd’hui de par le monde ont sans doute plus de chance d’entendre, pour la première fois, prononcer le nom de « Picasso » à propos d’une voiture que de l’un des peintres les plus influents du XX e siècle. C’est là le signe de l’extrême porosité actuelle entre l’art et la culture populaire. C’est aussi le résultat d’une longue partie de yo-yo entre High and Low entamée il y a près d’un siècle.
On fêtera, en effet, bientôt le centenaire de l’invention du ready-made par Marcel Duchamp. Depuis, le principe qui consiste à s’emparer d’un objet de consommation courante pour l’introduire dans la sphère de l’art a fait florès. La plupart des avant-gardes historiques – Dada, le Surréalisme, le Pop Art, l’Internationale situationniste, la Picture Generation et le postmodernisme – ont largement éprouvé les inépuisables ressources plastiques de l’appropriation, à tel point que celle-ci est aujourd’hui devenue un médium à part entière. On a maintenant recours à la technique de l’appropriation comme un artiste du quattrocento utilisait la camera obscura, ou comme un peintre du dimanche ferait de l’aquarelle. Tout le monde la pratique désormais : l’artiste vers lequel tous les regards se tournent, l’étudiant des Beaux-Arts, ma voisine ou mon cousin et même les directeurs artistiques des grandes compagnies automobiles.
Eau, gaz et images à tous les étages
Le développement d’Internet, la multiplication des sites de recherche ou de partage d’images en ligne – Flickr, Photobucket, Facebook, Google Images, eBay, pour ne citer que les plus connus – permettent aujourd’hui une accessibilité aux ressources visuelles qui était encore inimaginable il y a dix ans. C’est là un phénomène comparable à l’installation, au XIXesiècle, dans les immeubles des grandes villes, des réseaux d’eau courante puis de gaz. On sait combien ces nouvelles commodités de l’habitat moderne ont modi é en profondeur les modes de vie, le confort et l’hygiène. Nous avons désormais à domicile un robinet à images qui bouleverse tout aussi radicalement nos habitudes visuelles. Dans l’histoire de l’art, les périodes où l’accessibilité aux images était facilitée par une innovation technologique ont toujours été marquées par d’importantes avancées plastiques. Les progrès des procédés d’impression photomécaniques et l’essor subséquent de la presse illustrée dans les années 1910 et 1920 ont ainsi permis l’apparition du photomontage. De semblables bouleversements dans le champ de l’art peuvent être observés avec le développement de la gravure populaire au XIXe siècle, avec l’avènement de la télévision dans les années 1950... Et celui d’Internet aujourd’hui.
Appropriationnisme digital
Banalisation de l’appropriation d’une part, hyperaccessibilité aux images de l’autre, la conjonction de ces deux facteurs est particulièrement féconde. Elle crée les conditions d’une stimulation artistique. Et, en effet, depuis les premières années du nouveau millénaire – Google Images date de 2001, Google Maps est lancé en 2004, Flickr la même année –, les artistes se sont emparés des nouvelles technologies. Depuis, ils sont chaque jour un peu plus nombreux à mettre à pro t les richesses que leur offre Internet. De la manière la plus décomplexée, ils s’approprient ce qu’ils découvrent sur leur écran, éditent, transforment, déplacent, ajoutent ou retranchent. Ce que les artistes cherchaient autrefois dans la nature, en déambulant dans les villes, en feuilletant les magazines, ou en fouillant dans les cartons des marchés aux puces, ils le trouvent aujourd’hui sur la Toile. L’Internet est une nouvelle source de langage vernaculaire, un puits sans fond d’idées et d’émerveillements.
Pour une écologie des images
Ce ne serait guère favoriser l’intelligibilité du phénomène que de l’aborder à travers le seul prisme de la nouveauté. Les travaux qui résultent de ces pratiques d’appropriation digitale ne sont pas fondamentalement nouveaux, au sens où le modernisme concevait ce terme: ils ne cherchent à être ni originaux ni révolutionnaires. Mais ils poussent en revanche beaucoup plus loin des logiques qui étaient à l’œuvre depuis quelques décennies. Ils recherchent
16
l’intensité, radicalisent les positions et, ce faisant, ils commencent à faire bouger les lignes. Les artistes réunis ici s’inscrivent par exemple tous dans le grand mouvement de désacralisation du savoir-faire artistique entamé au début du XXe siècle au pro t d’une célébration du choix de l’artiste. Plutôt que d’ajouter des images aux images, ils préfèrent également recycler l’existant. Ils revendiquent une forme de principe écologique appliqué aux images. Cela confère au processus créatif un caractère beaucoup plus ludique qui fait la part belle à la trouvaille, à la sérendipité et à la poésie involontaire. Ils partagent aussi le désir de rendre encore un peu plus caduques les critères d’évaluation qui permettaient autrefois de déterminer ce qui est de l’art et ce qui n’en est pas.
Le suicide simulé de l’auteur
Les artistes présentés dans cette exposition ont aussi en commun de revaloriser la gure de l’amateur tout en dépréciant celle de l’auteur. Leur héros n’est plus le technicien, l’ingénieur ou le professionnel qui possède un savoir-faire, une expertise ou un métier et recherche une certaine qualité, mais bien plutôt l’amateur ou le collectionneur qui pratique sa passion en dilettante. Ce qui est en jeu ici, ce n’est plus « la mort de l’auteur » telle que Roland Barthes l’avait décrite en 1968, mais bien plutôt son suicide simulé. Pour l’appropriationniste qui travaille à l’ère du tout numérique, il ne s’agit plus de nier son statut d’auteur, mais plutôt de jouer, ou de faire croire, à sa propre disparition tout en sachant que ce jeu ne trompe désormais plus personne. On conviendra aisément que le problème ne se pose pas ici en termes de nouveauté, mais bien d’intensité.
La petite monnaie de l’art
Le grand mouvement d’appropriationnisme digital, dont cette exposition dresse encore maladroitement les premiers éléments de cartographie, nous révèle une chose essentielle. Nous vivons sur des filons d’images. Ces gisements se sont accumulés depuis maintenant près de deux siècles. Leur sédimentation progresse désormais de manière exponentielle. À l’instar de ces ressources dont notre planète est naturellement dotée, c’est là une énergie à la fois fossile et renouvelable. C’est aussi une extraordinaire richesse. Il suffit de creuser un peu, de tamiser doucement l’eau du ruisseau, pour voir apparaître les premières pépites. La ruée vers l’or a d’ailleurs déjà commencé. Sur la tombe d’André Breton, au cimetière des Batignolles à Paris, son épitaphe indique « je cherche l’or du temps ». Il fut parmi les premiers à comprendre que les images analogiques constituaient une source intarissable de merveilleux et étaient, de ce fait, notre plus grande richesse. Son ami Paul Éluard disait des cartes postales photographiques, dont il faisait passionnément la collection, qu’elles n’étaient pas de l’art, « tout au plus la petite monnaie de l’art », mais qu’elles donnaient « parfois l’idée de l’or ». Les artistes qui exploitent, depuis quelques années déjà, toutes les ressources des technologies numériques ont suivi ce filon. Ils agissent eux aussi en éclaireurs et nous montrent du doigt le chemin de la fortune.
Clément Chéroux
L’OR DU TEMPSMa voiture s’appelle Picasso
Ceux qui naissent aujourd’hui de par le monde ont sans doute plus de chance d’entendre, pour la première fois, prononcer le nom de « Picasso » à propos d’une voiture que de l’un des peintres les plus influents du XX e siècle. C’est là le signe de l’extrême porosité actuelle entre l’art et la culture populaire. C’est aussi le résultat d’une longue partie de yo-yo entre High and Low entamée il y a près d’un siècle.On fêtera, en effet, bientôt le centenaire de l’invention du ready-made par Marcel Duchamp. Depuis, le principe qui consiste à s’emparer d’un objet de consommation courante pour l’introduire dans la sphère de l’art a fait florès. La plupart des avant-gardes historiques – Dada, le Surréalisme, le Pop Art, l’Internationale situationniste, la Picture Generation et le postmodernisme – ont largement éprouvé les inépuisables ressources plastiques de l’appropriation, à tel point que celle-ci est aujourd’hui devenue un médium à part entière. On a maintenant recours à la technique de l’appropriation comme un artiste du quattrocento utilisait la camera obscura, ou comme un peintre du dimanche ferait de l’aquarelle. Tout le monde la pratique désormais : l’artiste vers lequel tous les regards se tournent, l’étudiant des Beaux-Arts, ma voisine ou mon cousin et même les directeurs artistiques des grandes compagnies automobiles.
Eau, gaz et images à tous les étages
Le développement d’Internet, la multiplication des sites de recherche ou de partage d’images en ligne – Flickr, Photobucket, Facebook, Google Images, eBay, pour ne citer que les plus connus – permettent aujourd’hui une accessibilité aux ressources visuelles qui était encore inimaginable il y a dix ans. C’est là un phénomène comparable à l’installation, au XIXesiècle, dans les immeubles des grandes villes, des réseaux d’eau courante puis de gaz. On sait combien ces nouvelles commodités de l’habitat moderne ont modi é en profondeur les modes de vie, le confort et l’hygiène. Nous avons désormais à domicile un robinet à images qui bouleverse tout aussi radicalement nos habitudes visuelles. Dans l’histoire de l’art, les périodes où l’accessibilité aux images était facilitée par une innovation technologique ont toujours été marquées par d’importantes avancées plastiques. Les progrès des procédés d’impression photomécaniques et l’essor subséquent de la presse illustrée dans les années 1910 et 1920 ont ainsi permis l’apparition du photomontage. De semblables bouleversements dans le champ de l’art peuvent être observés avec le développement de la gravure populaire au XIXe siècle, avec l’avènement de la télévision dans les années 1950... Et celui d’Internet aujourd’hui.
Appropriationnisme digital
Banalisation de l’appropriation d’une part, hyperaccessibilité aux images de l’autre, la conjonction de ces deux facteurs est particulièrement féconde. Elle crée les conditions d’une stimulation artistique. Et, en effet, depuis les premières années du nouveau millénaire – Google Images date de 2001, Google Maps est lancé en 2004, Flickr la même année –, les artistes se sont emparés des nouvelles technologies. Depuis, ils sont chaque jour un peu plus nombreux à mettre à pro t les richesses que leur offre Internet. De la manière la plus décomplexée, ils s’approprient ce qu’ils découvrent sur leur écran, éditent, transforment, déplacent, ajoutent ou retranchent. Ce que les artistes cherchaient autrefois dans la nature, en déambulant dans les villes, en feuilletant les magazines, ou en fouillant dans les cartons des marchés aux puces, ils le trouvent aujourd’hui sur la Toile. L’Internet est une nouvelle source de langage vernaculaire, un puits sans fond d’idées et d’émerveillements.
Pour une écologie des images
Ce ne serait guère favoriser l’intelligibilité du phénomène que de l’aborder à travers le seul prisme de la nouveauté. Les travaux qui résultent de ces pratiques d’appropriation digitale ne sont pas fondamentalement nouveaux, au sens où le modernisme concevait ce terme: ils ne cherchent à être ni originaux ni révolutionnaires. Mais ils poussent en revanche beaucoup plus loin des logiques qui étaient à l’œuvre depuis quelques décennies. Ils recherchent l’intensité, radicalisent les positions et, ce faisant, ils commencent à faire bouger les lignes. Les artistes réunis ici s’inscrivent par exemple tous dans le grand mouvement de désacralisation du savoir-faire artistique entamé au début du XXe siècle au profit d’une célébration du choix de l’artiste. Plutôt que d’ajouter des images aux images, ils préfèrent également recycler l’existant. Ils revendiquent une forme de principe écologique appliqué aux images. Cela confère au processus créatif un caractère beaucoup plus ludique qui fait la part belle à la trouvaille, à la sérendipité et à la poésie involontaire. Ils partagent aussi le désir de rendre encore un peu plus caduques les critères d’évaluation qui permettaient autrefois de déterminer ce qui est de l’art et ce qui n’en est pas.
Le suicide simulé de l’auteur
Les artistes présentés dans cette exposition ont aussi en commun de revaloriser la gure de l’amateur tout en dépréciant celle de l’auteur. Leur héros n’est plus le technicien, l’ingénieur ou le professionnel qui possède un savoir-faire, une expertise ou un métier et recherche une certaine qualité, mais bien plutôt l’amateur ou le collectionneur qui pratique sa passion en dilettante. Ce qui est en jeu ici, ce n’est plus « la mort de l’auteur » telle que Roland Barthes l’avait décrite en 1968, mais bien plutôt son suicide simulé. Pour l’appropriationniste qui travaille à l’ère du tout numérique, il ne s’agit plus de nier son statut d’auteur, mais plutôt de jouer, ou de faire croire, à sa propre disparition tout en sachant que ce jeu ne trompe désormais plus personne. On conviendra aisément que le problème ne se pose pas ici en termes de nouveauté, mais bien d’intensité.
La petite monnaie de l’art
Le grand mouvement d’appropriationnisme digital, dont cette exposition dresse encore maladroitement les premiers éléments de cartographie, nous révèle une chose essentielle. Nous vivons sur des filons d’images. Ces gisements se sont accumulés depuis maintenant près de deux siècles. Leur sédimentation progresse désormais de manière exponentielle. À l’instar de ces ressources dont notre planète est naturellement dotée, c’est là une énergie à la fois fossile et renouvelable. C’est aussi une extraordinaire richesse. Il suffit de creuser un peu, de tamiser doucement l’eau du ruisseau, pour voir apparaître les premières pépites. La ruée vers l’or a d’ailleurs déjà commencé. Sur la tombe d’André Breton, au cimetière des Batignolles à Paris, son épitaphe indique « je cherche l’or du temps ». Il fut parmi les premiers à comprendre que les images analogiques constituaient une source intarissable de merveilleux et étaient, de ce fait, notre plus grande richesse. Son ami Paul Éluard disait des cartes postales photographiques, dont il faisait passionnément la collection, qu’elles n’étaient pas de l’art, « tout au plus la petite monnaie de l’art », mais qu’elles donnaient « parfois l’idée de l’or ». Les artistes qui exploitent, depuis quelques années déjà, toutes les ressources des technologies numériques ont suivi ce filon. Ils agissent eux aussi en éclaireurs et nous montrent du doigt le chemin de la fortune.
Clément Chéroux
Commissaires: Clément Chéroux, Joan Fontcuberta, Erik Kessels, Joachim Schmid, Martin Parr
Exposition réalisée avec
le soutien de l’Ambassade
des Pays-Bas en France
et de la Mondriaan Foundation, Amsterdam.
Tirages de l’exposition réalisés en partie par Picto, Paris.
Encadrements de l’exposition réalisés en partie par Circad, Paris, Cadre en Seine, Rouen,
et Plasticollage, Paris.
Exposition présentée
à l’Atelier de Mécanique.
Commissaires: Clément Chéroux, Joan Fontcuberta, Erik Kessels, Joachim Schmid, Martin ParrExposition réalisée avec le soutien de l’Ambassade des Pays-Bas en France et de la Mondriaan Foundation, Amsterdam.
Tirages de l’exposition réalisés en partie par Picto, Paris.
Encadrements de l’exposition réalisés en partie par Circad, Paris, Cadre en Seine, Rouen, et Plasticollage, Paris.
Exposition présentée à l’Atelier de Mécanique.